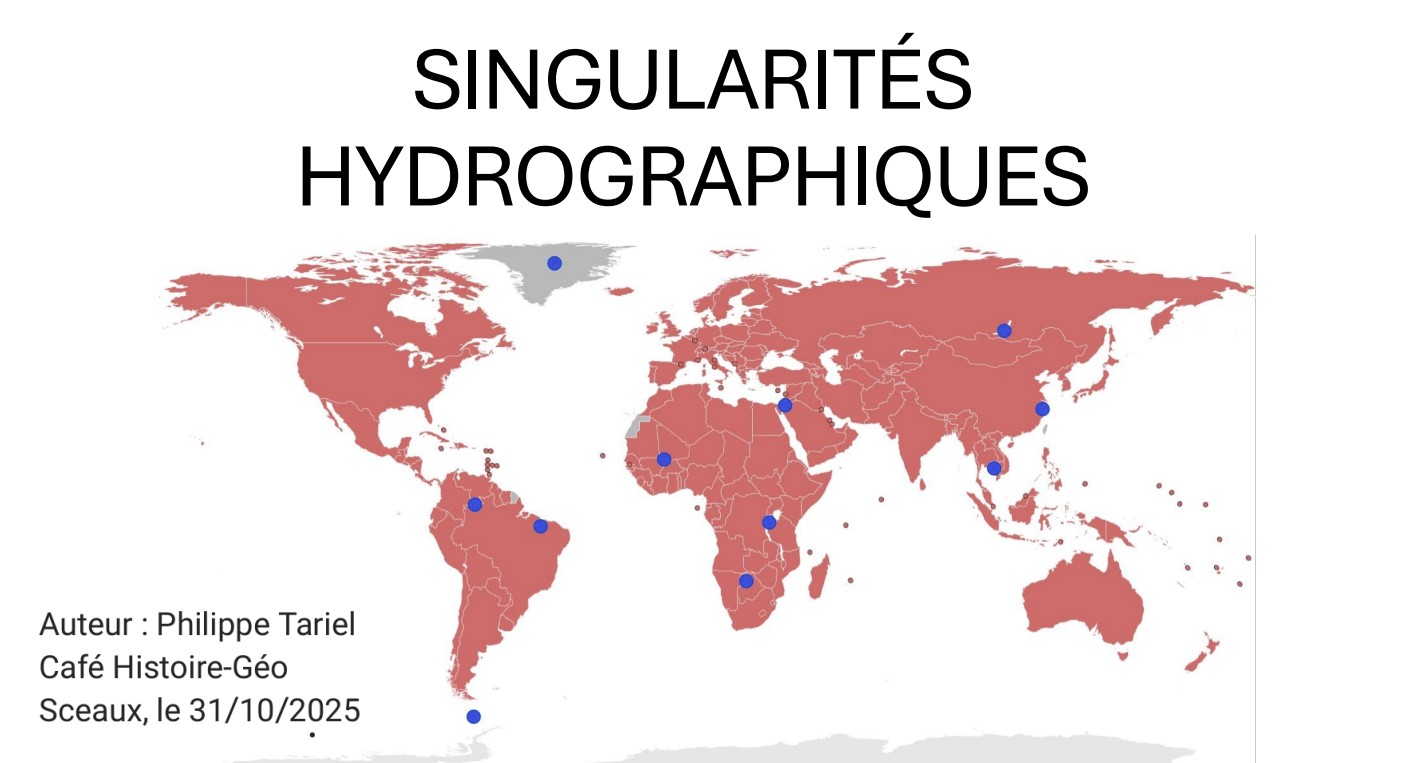SCEAUX Le Café Histoire-Géo propose tous les vendredis un sujet choisi parmi les propositions qui lui sont faites. L’association réunit les curieux en son quartier général, le Patio, l’indispensable café des Blagis. Le vendredi de la fin octobre Philippe Tariel présentait onze bizarreries de la nature, plus précisément issues des eaux, de fleuves, de lacs et de mers. Il associait aux nombreuses photos montrées sur un écran ses propres émerveillements et la poésie naturelle, sans assaisonnement, des mots de la géographie. Il avait choisi la forme d’un quiz de onze questions.
Une connexion naturelle entre deux bassins fluviaux
Normalement, les bassins fluviaux sont séparés par des lignes de partage des eaux (crêtes, reliefs). L’eau qui tombe d’un côté s’écoule vers un bassin, celle de l’autre côté vers un autre bassin. Des exceptions existent à cette règle géographique. Dans l’exemple à trouver, la raison vient de la déclivité extrêmement faible des deux bassins. Appelons par son nom, le canal de Casiquiare, cette connexion naturelle entre les bassins de l’Orénoque et de l’Amazone. On apprend que ce phénomène avait déjà fasciné Alexandre von Humboldt lors de ses explorations au XIXe siècle.
Un cours d’eau qui change de sens
Au cœur du Cambodge, entre les temples d’Angkor et la capitale Phnom Penh, un cours d’eau a cette singularité d’inverser son sens d’écoulement selon les saisons. De novembre à mai, durant la saison sèche, il descend vers le sud pour rejoindre le Mékong, le grand fleuve nourricier de la région. Lorsqu’arrive la saison des pluies, de mai à novembre, tout bascule. Le Mékong entre en crue, gonflé par les pluies de mousson, et sa puissance est telle qu’elle contraint le cours d’eau à inverser sa direction. Il remonte alors vers le nord, alimentant un vaste lac qui joue alors le rôle de réservoir naturel.
Ce phénomène hydraulique « se traduit par une inondation aussi bénéfique qu’attendue, explique Philippe Tariel, qui transforme la région en une immense zone de pêche, l’une des plus productives d’eau douce au monde, et fertilise les terres cultivables lors de la décrue. » Il est à la fois lac et cours d’eau, c’est le Tonlé Sap.
Un fleuve dont le principal delta se trouve à plus de 3 000 kilomètres de son embouchure
Le delta intérieur s’étend entre Bamako, la capitale du Mali, et Tombouctou, cité des sables. Il s’agit du Niger. Il se divise en de nombreux bras qui forment des îles avant de reprendre son cours (de se rassembler) 400km plus loin ! C’est la plus grande zone humide de l’Afrique de l’Ouest.
Le parcours de ce fleuve défie toute logique apparente. Il naît dans les montagnes de Guinée, à seulement 300 kilomètres de l’océan Atlantique. Mais au lieu de prendre le chemin le plus court vers la mer, il s’en éloigne, s’enfonçant dans les terres vers le nord-est. Puis, après avoir traversé le Mali et atteint les confins du Sahara, il opère un virage spectaculaire, presque un angle droit, et repart vers le sud-est. Le parcours du Niger est en forme de boomerang. Il traverse le Niger (qui lui doit son nom), longe le Bénin et le Nigeria, avant de finir enfin sa course dans le golfe de Guinée, formant cette fois un delta maritime parmi les plus vastes d’Afrique..
Cours d’eau endoréique
« Qu’est-ce qu’un cours d’eau endoréique ? » demande Philippe Tariel. On a la réponse dans l’assistance : un fleuve dont l’embouchure n’est pas maritime. « Le cas le plus étonnant est quand il se termine dans les terres. » Le fleuve en question prend sa source dans les hauts plateaux d’Angola, où les pluies abondantes gonflent les eaux. Il s’écoule ensuite vers le sud-est, formant par endroits la frontière naturelle avec la Namibie. Il termine son cours dans les sables du désert du Kalahari, au Botswana. Progressivement, l’eau s’évapore ou s’infiltre dans les sables, et l’Okavango disparait sans avoir atteint la mer.
Précision apportée. Le record de longueur d’un cours d’eau endoréique appartient à la Chine, avec le Tarim, qui s’écoule sur plus de 2.000 kilomètres, pour finir sa course dans le très aride désert du Taklamakan.
Mascarets
Un mascaret, on le sait, se produit quand la mer, poussée par les grandes marées, remonte vers l’embouchure d’un fleuve sous forme d’une vague déferlante. Le flux de la marée montante rencontre le courant descendant du fleuve, créant une onde puissante qui progresse en amont. Tous dans la salle connaissaient la baie du Mont-Saint-Michel.
Mais le mascaret le plus impressionnant au monde se trouve en Chine. Il se déchaîne chaque année à la mi-septembre sur le fleuve Qiantang, au sud de Shanghai. Les croisements de vagues créent des murs d’eau pouvant dépasser 9 mètres de hauteur, le Dragon d’argent.
Mascaret en pleine nature
Le principal mascaret en pleine nature se manifeste sur le fleuve Mearim, un fleuve de la région amazonienne. Son nom, Pororoca, est issu de la langue tupie, littéralement « rugissement ».
À la saison des pluies, entre mars et mai, sous l’effet de la nouvelle et de la pleine lune, la marée montante vient s’opposer au courant du fleuve et forme une vague d’une puissance incroyable, une sorte de chaos aquatique. Les surfeurs du monde viennent le défier.
Le plus grand canyon du monde
Un canyon est une vallée profonde aux parois abruptes, creusée par l’érosion d’un cours d’eau au fil de millions d’années. Mais celui dont il est question ici présente la particularité d’être totalement dissimulé sous une épaisse calotte glaciaire. Invisible à l’œil nu, il est enseveli sous des centaines de mètres, voire des kilomètres de glace. Il n’a été découvert que récemment grâce à de nouvelles technologies de radar.
Sa longueur de quelque 750 kilomètres est presque celle entre Paris et Toulouse. Caché sous une calotte glaciaire atteignant 3 kilomètres par endroits et d’une largeur allant jusqu’à 10 kilomètres, le Grand Canyon du Groenland creuse la roche dans des gouffres terrestres avant de déboucher dans l’océan Arctique.
Quel est le courant maritime le plus puissant du monde ?
Ce courant colossal trouve son origine dans le mouvement de séparation de deux immenses plaques géologiques : celle de l’Antarctique et celle de l’Amérique du Sud. Le résultat ? Un flux océanique qui brasse simultanément les eaux de trois océans : l’océan Indien, l’océan Pacifique et l’océan Atlantique et fait le tour du continent Antarctique. Son débit est estimé à 150 millions de mètres cubes par seconde, 600 fois le débit de l’Amazone, le fleuve le plus puissant de la planète.
La température de surface varie entre -2°C et 14°C selon les saisons et les latitudes. Les eaux froides sont aussi plus salées que la moyenne, ce qui les rend plus denses et plus lourdes. Elles plongent alors vers les profondeurs et se diffusent dans tous les océans du monde. De sorte que le Courant Circumpolaire Antarctique joue un rôle crucial dans les échanges thermiques entre les hémisphères nord et sud.
Où se trouve le système hydrographique le plus bas de la planète ?
À plus de 400 mètres sous le niveau de la mer repose une étendue d’eau dont la salinité atteint plus de 27%, soit près de sept fois celle des océans qui avoisine les 4%. Cette concentration rend toute vie aquatique impossible. On est ici dans un désert et le soleil implacable évapore l’eau de la mer et du fleuve qui s’y jette. D’autant que celui-ci est intensivement utilisé pour l’irrigation agricole. Le constat s’impose alors : année après année, les rives reculent. C’est l’ensemble de la mer Morte et du Jourdain qui sont menacés. Non loin de ses rivages, située à 240 mètres sous le niveau de la mer, se dresse Jéricho, la ville dont la Bible raconte que les trompettes firent tomber les murailles.
Quelles sont les sources du Nil ?
Pour simple qu’elle semble, la question est à la fois complexe et controversée. Les confluences sont innombrables, et déterminer laquelle mérite d’être consacrée comme « la » source relève autant de la politique que de l’hydrographie. Déjà, deux bras majeurs alimentent le fleuve. Le Nil Bleu descend des hauts plateaux d’Éthiopie. Le Nil Blanc descend de la région des Grands Lacs africains. Celui-ci, au début, est simple à remonter : on trouve le lac Albert et l’immense lac Victoria, véritable mer intérieure. Mais au-delà, les pistes se brouillent. De nombreuses rivières alimentent le lac Victoria. Les intérêts nationalistes prennent alors le pas sur la rigueur scientifique. Le Rwanda comme le Burundi revendiquent d’abriter la source « véritable ». On aura aussi appris que depuis l’Antiquité, le sujet passionne les savants et qu’Hérodote supposait qu’un grand fleuve venu de l’ouest (il confondait alors le cours supérieur du Nil Blanc avec le Niger) changeait mystérieusement de direction pour repartir vers le nord.
Quel est le lac le plus profond du monde ?
La profondeur maximale atteint plus de 1 600 mètres sous la surface et la moyenne s’établit déjà à 750 mètres. À de telles profondeurs, la pression est écrasante, la lumière a depuis longtemps disparu, « même si la pureté de l’eau du lac en assure la transparence jusqu’à 40 mètres », et les conditions rappellent davantage celles des fonds marins que celles d’un simple lac continental.
Situé en Sibérie orientale, le lac Baïkal est une véritable mer intérieure. Elle contient à elle seule environ 20% des réserves mondiales d’eau douce. Et c’est dans ces abysses que Philippe Tariel en termina avec son quiz explorateur et son album photo des quatre coins du monde.
Pour en savoir plus
La présentation de Philippe Tariel et son adresse mail : tarielsf@club-internet.fr
Le Café Histoire-Géo propose tous les vendredis de 14h45 à 16h00 une conférence sur un thème différent au Patio, le café du centre commercial des Blagis.