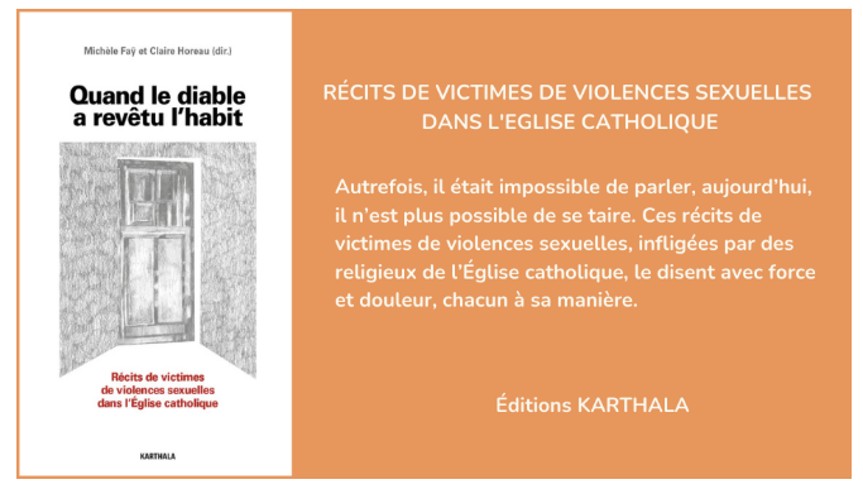Quand le diable a revêtu l’habit est un recueil des récits. Des victimes de violences sexuelles au sein de l’Église ont partagé les forces contraires qui les oppressent depuis leur enfance. Dire le mal qu’on leur a fait. Faut-il vraiment le dire ? Que dire ? À qui ? Comment ? Voilà le livre. Michèle Faÿ, critique littéraire et animatrice d’ateliers d’écriture et Claire Horeau, magistrate honoraire ont coordonné les témoignages.
Le livre poursuit un but : sortir du « déni qui a brisé des vies ; témoigner pour les autres, faire communauté et dire la possibilité de résister ensemble ». Pour Claire Horeau, c’est un livre de « passage de victime à témoin ». Sachez qu’il entre dans un très large dispositif de réparation mis en place à l’initiative de l’Église elle-même.
Comment dire ?
Ils disent ce qu’ils ont tu pendant un demi-siècle. Ils recherchent dans leur mémoire les marques de leur passé d’enfant. Ils disent qu’au sein de l’église, dans des communautés, ils ont subi des souffrances sexuelles du fait d’adultes protégés par leur statut d’enseignant, par l’incrédulité des familles, par le silence de l’institution… dont le prestige valait blanc-seing. Ils disent que leur honte les a abîmés, détruits pour certains.
Ceux qui sont « morts » sont encore vivants. Ce qui est mort en eux, ce qui survit quand même est dans le livre. La foi pour certains, la seule volonté de vivre pour d’autres, leur dit qu’il faut raconter à leur Église ce qui s’y est commis. Car les actes, les prédations, les viols n’ont pas été à leurs yeux des actes isolés mais des actes couverts.
Le livre peut être lu comme une conversation (douloureuse) à l’intérieur de l’Église. Et il l’est d’une certaine façon, on va le voir. Une urgence catholique à nettoyer les écuries d’Augias. Mais Claire Horeau pense qu’il va au-delà : « jusqu’à la cause des enfants abusés. » Elle sait, d’expérience de magistrate, combien cette cause est générale. Il faut que l’Église ne refasse plus, mais au-delà, « pour qu’on ne refasse plus. » Gaétan Supertino écrit à propos du livre dans Le Monde du 11 juin 2024, que toutes les victimes « racontent, à des degrés divers, la manière dont leur agresseur a été protégé et le manque de soutien de l’institution. » Le mot « institution » est sans doute une des clés d’entrée dans cette généralité qui ne doit plus se reproduire.
La honte est dans la salissure
Ceux qui, enfants, devaient se taire à défaut de quoi, ils auraient « trahi », sont ceux qui vivent aujourd’hui la trahison d’une Église, censée apporter un « message d’amour » et certainement pas celui-là. Institution et trahison, il y a un là couple étrange qui semble vieux comme le monde.
Les « détails » sont dans le livre. Très pudiquement souvent. Les abus sont très variables et parfois à peine décrits. L’optique est ajustée sur les conséquences racontées par les victimes (dépressions, décrochages scolaires). Les textes aussi partagent le sentiment de honte. Honte d’avoir été être sali, comme par une contamination venue on ne sait d’où, tombée sur soi, toujours. On se perçoit comme indigne, défectueux, inacceptable.
La culpabilité porte sur un acte précis (j’ai fait quelque chose de mal), mais la honte attaque l’identité (je suis mauvais, taché) comme si la violation avait condamné à être défectueux. À ne pas être propre. Honte d’avoir vécu. La culpabilité, étrangement, passe du côté de la victime.
Cette inversion des responsabilités, avec le temps, a produit de la colère. Surtout pour ceux qui n’ont pas été crus. Parce que certains racontaient et on ne les croyait pas. Ils inventaient, simulaient. Les institutions soutenaient la thèse du mensonge. Le livre veut faire en sorte que les institutions le sachent, l’admettent, réparent autant que faire se peut. Et puis, le temps continuant de passer comme il en a l’habitude, une sorte d’apaisement a permis de dire. Les victimes ont été aidées en cela.
Difficiles ressouvenirs
Il y a Etienne, Christian, Roland, Pierre… et sept autres, Lena une fille, les prénoms ont été changés. Des témoignages sont très explicites et accentuent le sentiment d’indignation face aux exactions d’adultes envers des enfants. D’autres témoignages sont flous, comme perdus dans des souvenirs dans lesquels le travail de censure laisse des béances. Il n’est pas sûr qu’il se souviennent de tout. N’importe. Mais il y a par moments des détails qui ne trompent guère même chez les plus pudiques.
La survenue d’un adulte dans le couloir a interrompu ce qui se déroulait. Le récit aux parents les a laissés de marbre. La « figure simiesque » d’un enseignant et son immonde « costume en tergal ». Une longue impuissance à dire. Quoi au juste ? Il ne s’étend pas. C’est Juju que le prof de judo, « religieux de son état », fait monter chez lui après les cours. Il le lave… Vous voyez le genre. Juju a onze ans.
Lena, 13 ans au moment des faits ne « voulait pas écrire », dit Claire Horeau. Il a fallu l’aider. Beaucoup. Peut-être un déplacement de l’anorexie dont elle souffrit adolescente. Ne pas manger, ne pas dire. Qui sait ? Toujours-est-il, qu’elle est toujours dans l’Église « je suis l’Église », dit-elle, que la « lettre du pape François au peuple de Dieu » a bouleversée. De même, Gérard est âgé de12 ans dans le juvénat situé dans un château dont un frère enseignant lui fait connaître les combles. Il gardera « foi dans le seigneur » et a fait de sa vie « un cheminement vers le Royaume ». Que comprendre ? Il s’en explique.
Publication comme part de réparation
Les acteurs de la publication ne sont pas neutres. Elle a été faite avec le concours de la CRR (Commission reconnaissance et réparation). Ce contexte est important. La CCR a été créée en novembre 2021 par la Conférence des religieux et religieuses de France en réponse à un rapport d’enquête qui venait d’être remis. Ce rapport, issu d’une enquête menée par la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église), révélait l’ampleur des violences commises depuis 1950 et recommandait des mesures concrètes pour reconnaître les victimes et réparer les préjudices. L’Église assumait sa responsabilité dans les abus commis.
Un dispositif d’accompagnement des victimes a été mis en place. Des professionnels de l’écoute et de la médiation ont aidé à la verbalisation. Puis un collège composé de médecins, de magistrats, d’avocats, etc. a rendu des décisions de reconnaissance et de réparation. La réparation pouvait être financière (pour permettre de lancer un projet, se réinscrire dans un futur), mais aussi symbolique ou créative (publication de lettres, d’œuvres, de témoignages) et c’est ici que prend place le livre Quand le diable a revêtu l’habit.
Dans la postface, Antoine Garapon, le président de la CRR, écrit : « Témoigner, c’est toujours faire communauté ». Il établit une sorte de condition, basée sur une symétrie, à moins que ça ne soit un effet miroir. Le livre est celui de passages de victimes à témoins. Et il appelle le lecteur à suivre un chemin identique : il doit se faire témoin. Le lecteur, témoin, mais de quoi ? Des retours à la vie de ceux qui se vécurent morts ? Quels retours vers quelles vies ? On n’en connaît que ces traces écrites, composées, recomposées un demi-siècle après. Lecteur témoin de ce qu’il imagine de la souffrance lancinante de ces enfants abusés ? Vous en jugerez.
Quand le diable a revêtu l’habit, Récits de victimes de violences sexuelles dans l’Église catholique, sous la direction de Michele Faÿ et Claire Horeau. Éditions Karthala,2024, 240 p. 20€